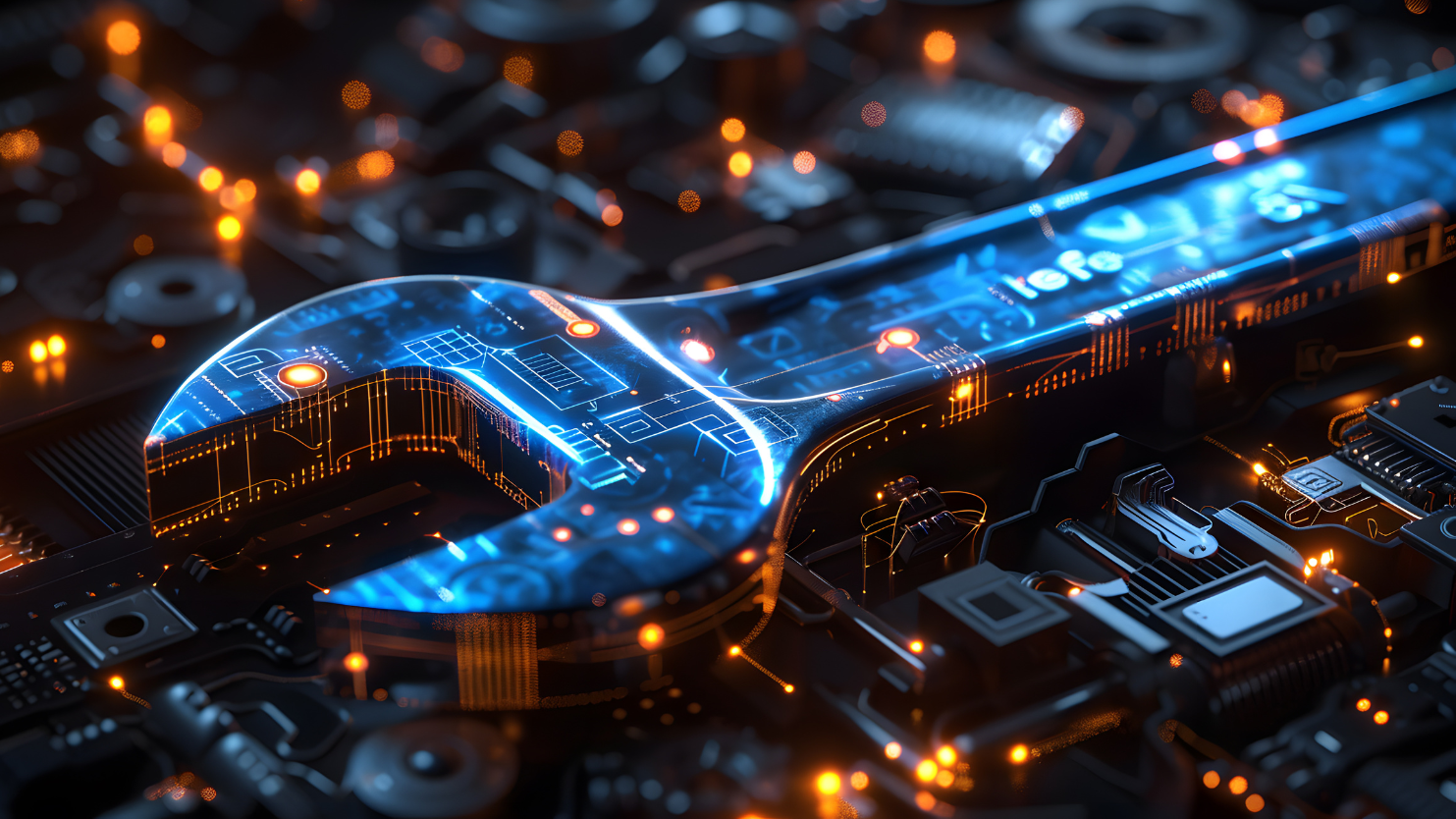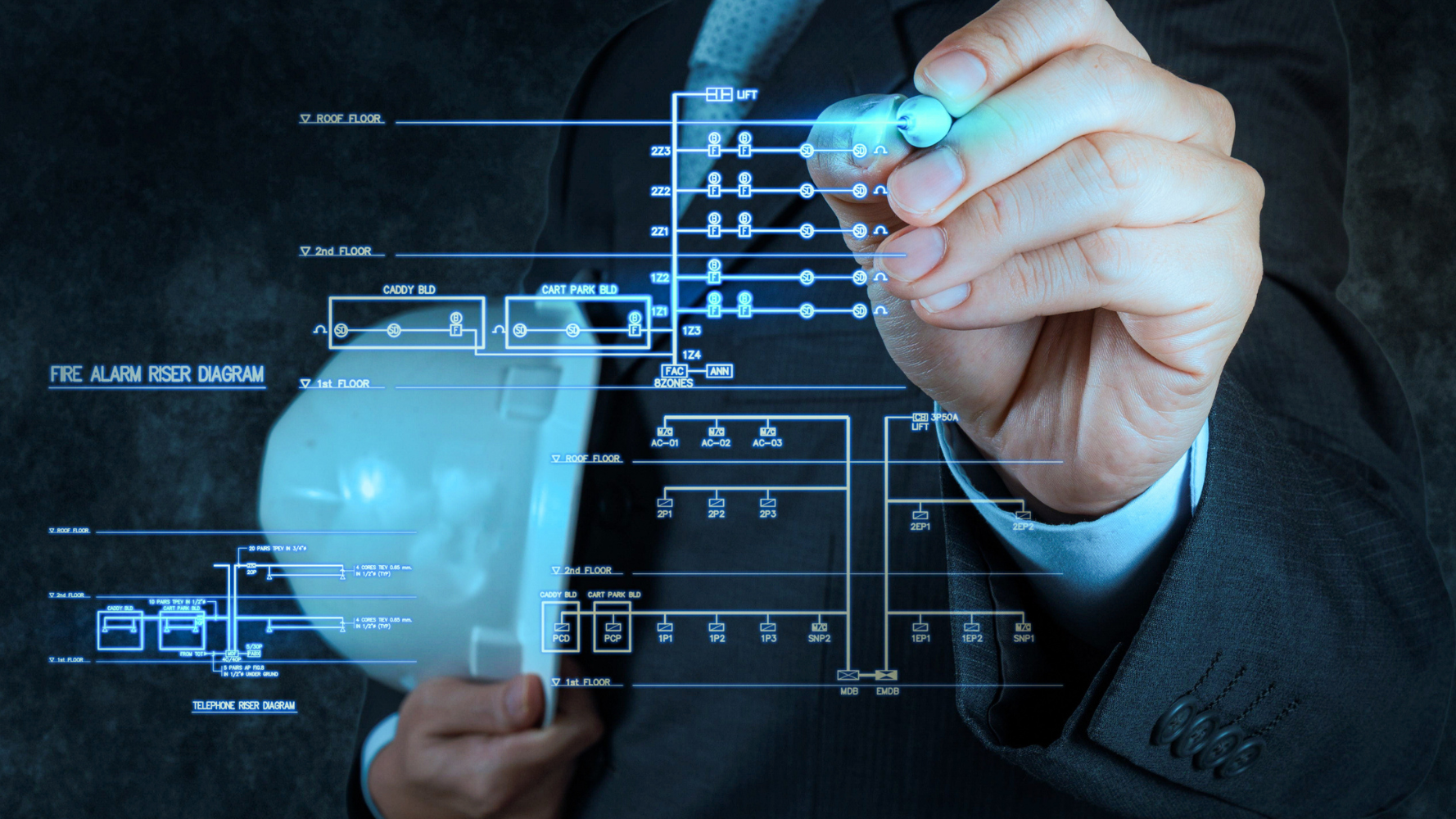Entre décarbonation, digitalisation et renforcement de la sécurité, le secteur travaux publics doit relever des défis de taille tout en répondant aux besoins croissants d’infrastructures performantes et durables. Témoignages.
Gilles Christnach
Directeur du CRTI-B
« Les projets de construction et de BTP représentent un levier puissant pour soutenir un secteur en pleine mutation, particulièrement dans le contexte actuel. Ces projets, souvent innovants et à la pointe du progrès, intègrent de plus en plus l’usage de données digitales. Cette transformation, à la fois sensible, pertinente et désormais inévitable, demande une réinvention des processus de construction. Intelligence artificielle, maquettes numériques, chatbots, plateformes collaboratives et même solutions de financement : ces outils se développent à une vitesse remarquable et offrent des avantages économiques considérables aux régions capables de les déployer rapidement, en toute sécurité et avec efficacité.
Le Luxembourg, qui a su bâtir sa réussite en identifiant et en exploitant des niches stratégiques, doit aujourd’hui veiller à préserver et renforcer sa compétitivité. Cela vaut pour de nombreux secteurs, et s’applique pleinement à la construction.
Dans un contexte où le logement est officiellement reconnu comme une priorité nationale, il est impératif que les autorités publiques agissent rapidement comme catalyseur de cette transformation, aux côtés et avec les acteurs privés présents sur le terrain. L’enjeu est clair : promouvoir ensemble une construction plus simple, plus saine, plus efficace et plus rapide, afin de répondre aux besoins du pays tout en consolidant notre position dans un marché international hautement compétitif. Forts des compétences réunies au Luxembourg, nous avons les moyens de multiplier les exemples récents de réalisations solides, innovantes et durables dans un environnement hautement digitalisé, qu’elles soient issues d’initiatives publiques ou privées. Alors, crise ou opportunité nationale, nous avons le choix ! »
Frédéric Saunier
Directeur de la division Travaux publics chez LSC360
« L’optimisation du dimensionnement est la pierre angulaire de toute stratégie visant à réduire l’empreinte carbone des ouvrages d’art. Grâce à des logiciels de calcul avancés intégrant l’ensemble des phases de construction, nous dimensionnons précisément les sections, minimisant ainsi l’utilisation de matériaux tout en garantissant la sécurité et la durabilité. La réhabilitation des ouvrages d’art existants, menée conformément aux normes européennes et recommandations techniques récentes, constitue un levier essentiel pour prolonger la durée de vie des structures.
Nos équipes, spécialement formées à cette évolution normative, conçoivent ces renforcements ciblés pour adapter les ouvrages aux charges et exigences actuelles. La conception de ponts intégraux - caractérisés par une continuité structurelle entre le tablier et les culées, sans appareils d’appui ni dispositifs de dilatation - réduit non seulement la quantité de matériaux et les coûts d’entretien, mais améliore aussi la rigidité globale et la durabilité de l’ouvrage. Le choix des matériaux renforce cette démarche. Nous privilégions l’acier bas carbone, issu de matières recyclées et d’énergies renouvelables, ainsi que le béton bas carbone, dont la performance repose avant tout sur l’utilisation de ciments à faible teneur en clinker. La préfabrication des éléments porteurs permet un contrôle strict des paramètres de fabrication, diminue les temps d’intervention, optimise la logistique et réduit les nuisances environnementales et sonores.
Cette approche globale offre une réponse concrète aux défis environnementaux, conciliant performance et durabilité. »
Fabrice Remlinger
Responsable des formations Engins, au sein du service Construction mécanisée à l’IFSB
« Aujourd’hui, deux priorités s’imposent aux entreprises de travaux publics ; la sécurité et la décarbonation. Ces enjeux modifient les pratiques sur chantier. Ils requièrent donc une évolution des compétences alors que, dans le même temps, nous constatons que nos métiers n’attirent plus les jeunes et que le niveau des stagiaires baisse.
En tant que centre de formation, nous nous adaptons à ces nouveaux profils et les accompagnons au plus près de la réalité du terrain. Ainsi, nous avons choisi d’intégrer la sécurité et la décarbonation au cœur de nos parcours pédagogiques à travers, par exemple, des modules sur l’économie circulaire ou sur l’éco-conduite. Les engins étant responsables d’environ un quart des émissions de CO₂ du secteur, il est crucial que chaque conducteur comprenne l’impact de ses gestes quotidiens : choisir le mode de fonctionnement adapté à la tâche à accomplir, éviter les ralentis moteurs, soigner l’entretien de sa machine sont autant de leviers pour réduire l’empreinte carbone de ses activités.
Chacun doit également intégrer les bonnes pratiques qui permettront de gagner en efficacité et en consommation énergétique, mais aussi en confort. L’angle de chargement d’un camion, par exemple, peut tout changer. Il en va de même côté sécurité où, même si de nombreux progrès ont été faits ces dernières années, certaines bonnes habitudes sont encore à prendre. C’est pourquoi nous insistons sur les fondamentaux, comme le port de la ceinture.
Nos formations mêlent pratique et innovation. L’objectif : aider chaque stagiaire à mesurer son impact sur l’environnement, le chantier, la performance globale de son entreprise et l’avenir de son métier. »
Propos recueillis par Mélanie Trélat
Article paru dans Neomag #73 - septembre 2025